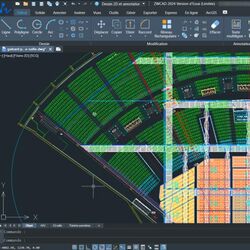Encore marginale en France, où elle ne représente que 5% de la production de chaleur[1], elle est pourtant un vecteur clé de la transition énergétique. Si elle s’est déjà imposée dans certaines zones géographiques avec des résultats concluants, d’autres aires propices restent inexploitées, quand bien même une maîtrise experte et reconnue de la technologie est prête à être déployée. La France doit tirer profit de ses acquis en la matière et saisir plus fermement l’opportunité que lui offre son patrimoine géologique pour renforcer sa souveraineté énergétique et accélérer sa décarbonation. Décryptage avec Caroline Guion, responsable du pôle Géothermie des réseaux de chaleur chez ENGIE Solutions.
Un gisement énergétique dormant sur des territoires à conquérir
La géothermie a déjà fait ses preuves sur les territoires au potentiel connu, qui offrent déjà de solides références en la matière. Le cœur de l’activité s’est développé en Île-de-France grâce au Dogger[2] et dans le Bassin aquitain où la géothermie profonde chauffe plus d’un million de personnes.
Des équipements concrets, gérés par ENGIE Solutions, fournissent des exemples caractéristiques fructueux du recours à cette énergie renouvelable. Citons notamment, dans le Bassin parisien, la centrale géothermique de Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne), qui alimente le réseau de chaleur urbain GéoMarne à 82%. En Aquitaine, à Bordeaux, les réseaux de chaleur Grand Parc Energies et Plaine de Garonne Energies, entre autres, offrent un mix énergétique reposant essentiellement sur la géothermie à hauteur de 86% et 80%. La géothermie a bel et bien apporté une réponse aux ambitions de décarbonation de ces aires pour fournir de la chaleur vertueuse aux logements, bâtiments publics et tertiaires et sites industriels.
Reste que la géothermie profonde est encore sous-exploitée dans certains territoires propices dont les ressources géothermales probables doivent être valorisées. On compte parmi eux la Bresse, aux confins du territoire suisse et le Hainaut, dans les Hauts-de-France, qui présentent un contexte géologique favorable.
Des questionnements et des idées reçues persistent quant à l’impact des campagnes d’investigation dans les territoires où la technologie n’est pas encore installée, notamment concernant la maîtrise du risque de sismicité ou encore les effets des forages sur les nappes phréatiques. Mettre en place une méthodologie scrupuleuse et s’entourer des meilleurs experts dans les différents domaines mobilisés apparaissent alors comme des éléments clés pour dépasser ces présomptions pesant sur la géothermie, en lever les freins et en accroître l’acceptabilité.
Une supervision optimale reposant sur une expertise plurielle
Les méthodes éprouvées appliquées à la géothermie, qui s’appuient sur l’audit d’un large collège d’experts et sur des partenariats de R&D avec de grands instituts de recherche, démontrent que rien n’est laissé au hasard lors des opérations diligentées.
C’est en effet par une méthodologie du « pas à pas » que l’on procède, à l’aide d’une supervision continue lors des investigations qui se poursuit lors de l’exploitation. Ce suivi en temps réel permet de minorer les risques et d’écarter la survenance d’incidents par une appréciation exacte de l’aléa.
Les expertises mobilisées témoignent de ces précautions prises en la matière et de l’exigence apportée au diagnostic du milieu. Tout un panel d’experts se penche sur les projets pour un audit à 360°. Des écologues, acousticiens, experts en génie civil réalisent une étude d’impact environnementale poussée et exhaustive tandis que des spécialistes de la modélisation et du forage, experts financiers, assureurs géologiques, universitaires ou encore cabinets d’études géophysiques sont à pied d’œuvre pour mener une étude techno-économique sur chaque projet. L’assurance de la faisabilité et de la viabilité environnementale du projet doit donc être démontrée pour être validée par la SAF-Environnement[3], la BEI[4], les assureurs et les services de l’Etat concernés.
Ajoutons que chaque projet appelle une réalisation sur-mesure en fonction du territoire concerné. Si une partie de la méthodologie est réplicable, la ressource géologique, elle, est toujours unique. Cela nécessite donc une adaptation indispensable aux caractéristiques spécifiques à chaque zone, comme cela a été le cas pour la Métropole de Toulouse, qui a misé sur la géothermie profonde pour étoffer son réseau de chaleur et de froid après une analyse détaillée des données existantes locales et régionales confortée par une acquisition sismique. C’est aussi la géothermie profonde qui devrait bientôt couvrir 32% des besoins en chaleur du réseau d’Aix-en-Provence, une ville pionnière en la matière. Le choix d’un mix énergétique combinant géothermie et biomasse assurera une diminution de 59% des polluants comparé à un projet 100% biomasse. On peut encore citer les Villes de Bois-d’Arcy, de Fontenay-le-Fleury et de Saint-Cyr-l’École, dans les Yvelines, qui elles aussi ont fait figure de précurseurs avec le dépôt d’un permis de recherche géothermique sur leurs trois communes pour évaluer le potentiel géothermique du sous-sol, jamais encore exploré aussi loin dans l’Ouest parisien, pour la réalisation d’un futur réseau de chaleur.
Il apparaît également primordial de faire preuve de la plus grande transparence vis-à-vis des collectivités et des citoyens sur ces projets. Ce n’est qu’en faisant circuler l’information, les données recueillies par les études et en organisant des temps d’échanges avec le public, dans la durée et avec sincérité et la plus grande ouverture, que nous, acteurs de la filière, pourrons enrichir les projets dans le sens de l’intérêt général et démystifier les idées reçues quant aux installations géothermiques.
Enfin, l’une des grandes forces de ces projets réside aussi dans leur capacité à alimenter la recherche fondamentale. A ce titre, les investigations préliminaires ne sont jamais diligentées « pour rien » puisqu’elles participent à une meilleure connaissance des sous-sols français. Au-delà des programmes de recherche mis en place pour chaque projet, ENGIE Solutions s’implique plus largement dans des programmes collaboratifs de R&D sur la géothermie. Pour illustration, un partenariat a été signé fin 2024, avec la Stadwerke de München, opérateur de chauffage urbain à Munich. L’objectif de cette coopération centrée sur les opérations de géothermie profonde et stockage de chaleur en réservoir profond est de bénéficier de retours d’expériences industriels mutuels sur des bassins géologiques analogues à Paris et à Munich. Le projet SAPHEA, quant à lui, réunit un consortium d’experts français, italiens, allemands ou encore autrichiens pour la création d’une plateforme européenne dédiée au développement de la géothermie.
Si ces initiatives, propres aux porteurs de projet, constituent un premier levier pour soutenir la géothermie, leur efficacité reste conditionnée à une évolution du cadre réglementaire.
Vers un renforcement du concours réglementaire comme effet de levier
Les aides nationales à la géothermie sont principalement assurées par l’ADEME et le fonds de garantie géothermie[5], mais leur impact est limité par l’absence de soutien spécifique dans les zones à potentiel. La complexité réglementaire allonge les délais d’instruction et freine le secteur. Il est donc essentiel de simplifier la réglementation et d’augmenter les ressources humaines dédiées à l’instruction des dossiers. Enfin, une meilleure consultation des experts de terrain permettrait d’aligner théorie et pratique pour atteindre l’objectif de doubler les projets géothermiques d’ici 2030.
En tout état de cause, la refonte des fonds de garantie doit être en meilleure adéquation avec les besoins des opérateurs et donner une impulsion au déploiement de la géothermie dans les territoires favorables mais restant à explorer. Le cœur des recommandations d’une mission flash sur les conséquences de la géothermie profonde[6] porte sur le renforcement de l’acceptabilité de la géothermie et sa déclinaison régionale. Le constat est sans équivoque : la géothermie est une « source d’énergie encore trop méconnue du grand public ou, malheureusement, bien connue à ses dépens »[7].
Tribune de Caroline Guion, responsable du pôle Géothermie des réseaux de chaleur chez ENGIE Solutions (Linkedin).
[1] Ministère de la Transition Ecologique et de la Cohésion des Territoires, Chiffres clés des énergies renouvelables, édition 2024, www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr.
[2] Le Dogger est le principal aquifère exploité en région parisienne, situé entre 1.500 et 2.000m de profondeur. Il s’agit de l’aquifère le plus exploité d’Europe.
[3] Filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations chargée par les pouvoirs publics de mettre en œuvre et de gérer les Fonds de garanties des risques géologiques et géothermiques.
[4] Banque européenne d’investissement.
[5] Administré par la SAF-Environnement.
[6] Mission flash menée en mars 2024 par la commission parlementaire du développement durable et de l'aménagement du territoire.
[7] Citations du député Vincent Thiébaut, co-rapporteur de la mission flash. Synthèse disponible sur www.assemblee-nationale.fr.
 DPE 2026 : une réforme technique qui rebat les cartes du logement en France
DPE 2026 : une réforme technique qui rebat les cartes du logement en France
 Le déchet, nouveau pilier de la performance dans le BTP
Le déchet, nouveau pilier de la performance dans le BTP
 Quand les marchés montent… mais que la qualité baisse : un signal à ne pas ignorer
Quand les marchés montent… mais que la qualité baisse : un signal à ne pas ignorer
 Marchés : l’optimisme sans frein
Marchés : l’optimisme sans frein
 Audit d’acquisition & croissance externe : les points de vigilance spécifiques au secteur du bâtiment
Audit d’acquisition & croissance externe : les points de vigilance spécifiques au secteur du bâtiment
 Quand le Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) vacille : et si la fraude fragilisait toute la chaîne immobilière
Quand le Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) vacille : et si la fraude fragilisait toute la chaîne immobilière
 Le peintre, artisan de l'automatisation du secteur de la construction
Le peintre, artisan de l'automatisation du secteur de la construction
 Chantiers publics, argent public... Qui veille vraiment sur le budget ?
Chantiers publics, argent public... Qui veille vraiment sur le budget ?
 Devis gonflés et imprécisions dans les audits, face à la fraude à MaPrimeRénov' les nécessaires visites sur place
Devis gonflés et imprécisions dans les audits, face à la fraude à MaPrimeRénov' les nécessaires visites sur place
 La reprise continue dans l'immobilier ancien, mais la remontée des prix inquiète
La reprise continue dans l'immobilier ancien, mais la remontée des prix inquiète
 PLF2026 : La CAPEB dénonce le vote des députés qui enterre la mesure d’équité fiscale entre les entreprises du bâtiment et appelle les sénateurs à réagir
PLF2026 : La CAPEB dénonce le vote des députés qui enterre la mesure d’équité fiscale entre les entreprises du bâtiment et appelle les sénateurs à réagir
 Immobilier neuf : taux stables et coup de pouce gouvernemental favorisent les primo-accédants
Immobilier neuf : taux stables et coup de pouce gouvernemental favorisent les primo-accédants