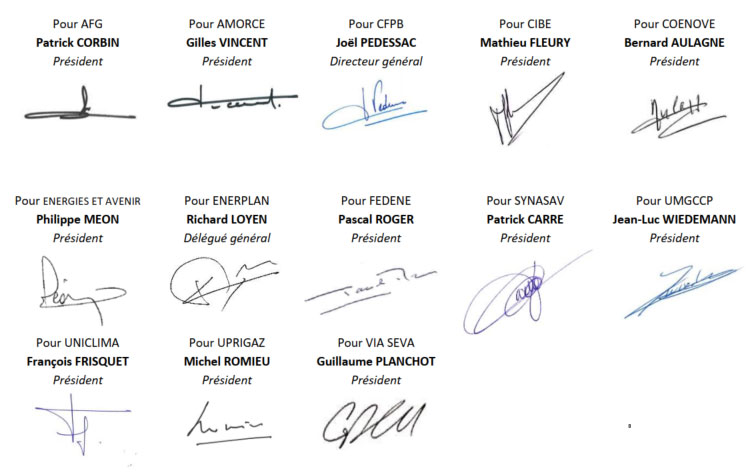Une copie cette lettre a également été envoyée à Madame Elisabeth Borne, Ministre de la Transition écologique et solidaire, Madame Emmanuelle Wargon, Secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire et Monsieur Julien Denormandie, Ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement.
Les 13 signataires sont :
Lettre ouverte : RE2020, facteur du chauffage électrique
Monsieur le Premier Ministre,
Par voie de communiqué, le Gouvernement vient d'annoncer une nouvelle étape dans la future réglementation énergétique des bâtiments neufs, dite « RE2020 », censée traduire l'ambition de la France en matière de lutte contre le réchauffement climatique.
L'ensemble des acteurs de la filière ont, dès l'origine, soutenu cette ambition et l'évolution de la réglementation énergétique pour y intégrer une composante carbone qui constitue le principal enjeu de notre transition.
Paradoxalement, ce même communiqué annonce comme un élément positif la modification de deux critères qui caractérisent et permettent d'évaluer le contenu carbone de l'électricité utilisée pour le chauffage électrique. Concrètement, il s'agit d'une modification très substantielle du fait que le facteur d'émission de l'usage chauffage de l'électricité passerait, artificiellement, d'une valeur actuellement de 210 grammes CO²/kWh à 79 grammes CO²/kWh. Autrement dit, le même radiateur électrique émettra demain 2,6 fois moins de carbone sans avoir rien modifié sur le fond.
Dans la pratique, la France présente une pointe de consommation électrique en hiver qui est fortement liée et corrélée au chauffage électrique (auquel s'ajoute un peu d'éclairage compte tenu de la moindre luminosité). Cette pointe oblige à mettre en route des installations de production électrique, en grande partie thermiques, et à importer de l'électricité plus carbonée venant de nos voisins européens. La valeur actuelle de 210 grammes du facteur d'émission repose sur la réalité du mix énergétique de la pointe d'hiver liée au chauffage, alors que la nouvelle valeur proposée, bien que dénommée, à tort, « par usage » ne représente que la moyenne totale en hiver de l'impact carbone, tous usages confondus. En parallèle, le gouvernement propose l'ajustement d'un autre facteur dit « coefficient d'énergie primaire », en se fondant sur une projection hypothétique du mix énergétique français moyen sur les 50 prochaines années plutôt que sur la réalité actuelle.La modification de ces critères, qui peut sembler anecdotique et technologique, présente cependant des conséquences concrètes tout à fait négatives. En effet, en retenant ces valeurs, qui ne reposent pas sur des méthodes éprouvées et partagées, le gouvernement favoriserait, de fait, le chauffage électrique, au détriment des autres énergies, et en particulier des solutions de chauffage par des énergies renouvelables (bois, géothermie, solaire, biogaz). Elle réduirait artificiellement le bénéfice environnemental de la rénovation énergétique des logements alors qu'il s'agit d'une priorité annoncée du gouvernement et alors que la réduction de la pointe électrique d'hiver carbonée est identifiée dans le projet de Programmation Pluriannuelle de l'Énergie comme un enjeu important. Cette manipulation risque d'avoir un effet inverse, avec des impacts négatifs non négligeables en termes d'émissions de carbone, de sécurité d'approvisionnement, de promotion de solutions de chauffage innovantes et sur le budget des ménages.
C'est pourquoi nous demandons au gouvernement de revoir les calculs du facteur d'énergie primaire et du contenu carbone de l'électricité avec les données existantes les plus récentes, en s'appuyant sur les méthodes de calcul pertinentes et éprouvées actuelles. Ceci répondrait aux avis, notamment émis par le CSE qui a exprimé son désaccord et par le CSCEE, qui a exprimé sa préoccupation pour ces propositions dont les conséquences n'ont été ni évaluées ni partagées avec les parties prenantes. C'est pourquoi également nous souhaitons vous rencontrer, afin de mieux vous exposer la situation et l'impact de ces orientations sur les solutions que nous mettons quotidiennement en œuvre pour accélérer la transition énergétique, partout sur le territoire.
Veuillez agréer, Monsieur le Premier ministre, l'expression de notre haute considération.
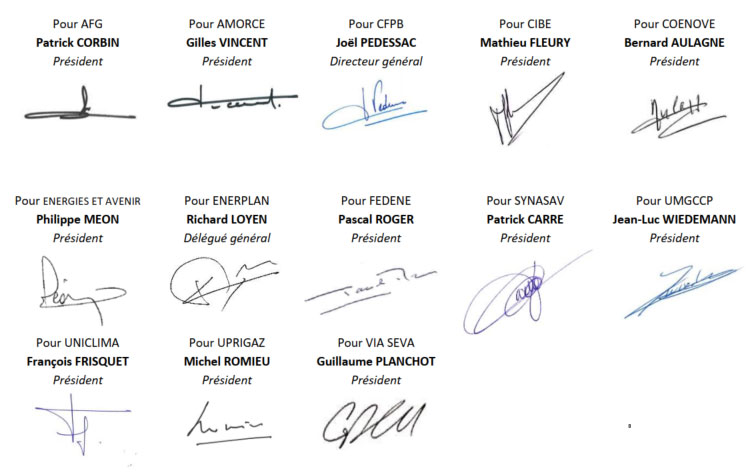
Pour Équilibre des Énergies, il n’y a plus lieu de polémiquer sur les arbitrages de la RE2020
Brice Lalonde, Président d'Équilibre des Énergies : « Assez de grenouillages contre la RE 2020. La priorité est la protection du climat, non les petits intérêts des uns ou des autres. C'est le gouvernement qui a raison. »
Le Gouvernement a fait connaître le 14 janvier 2020 ses principaux arbitrages relatifs à la fixation de certains paramètres nécessaires à la poursuite de la mise au point de la future réglementation environnementale des bâtiments, la RE2020.
Malgré les mois de discussion qui ont précédé ces arbitrages, certains continuent à en contester le bien-fondé. S’agissant d’arbitrages, personne ne pouvait espérer voir ses thèses entièrement satisfaites mais Équilibre des Énergies estime que le moment est venu de définir de façon pragmatique une trajectoire de progrès permettant de construire des bâtiments de plus en plus économes en énergie et de moins en moins émetteurs de gaz à effet de serre, afin de respecter l’objectif de neutralité carbone à présent fixé par la loi Énergie-Climat pour 2050.
Équilibre des Énergies propose à cet effet de rebaptiser la réglementation RE2020 en REC2020 : Réglementation Énergie-Climat 2020 afin d’être en ligne avec la toute récente loi Énergie-Climat.
Compte tenu des informations erronées diffusées par certaines parties prenantes, Équilibre des Énergies estime en outre nécessaire d’apporter certaines mises au point :
- Équilibre des Énergies se félicite que les dispositions prises allègent les contraintes pesant sur le développement de l’électricité qui ont fait que, depuis près de 10 ans, il était devenu pratiquement impossible de construire des logements collectifs chauffés à l’électricité alors que le gaz a conquis 75 % du marché, en totale contradiction avec la Stratégie Nationale Bas carbone.
Les dispositions arrêtées par le gouvernement ne favorisent pas le chauffage électrique par convecteurs plus que d’autres usages de l’électricité. Équilibre des Énergies rappelle par ailleurs que les logements chauffés à l’électricité (par pompes à chaleur ou par radiateurs et non plus par convecteurs) ont toujours été mieux isolés que les logements chauffés aux combustibles fossiles et que le choix de l’électricité dans les logements neufs permet d’alléger de 20 à 25 % le budget des ménages.
- Concernant le coefficient de conversion de l’électricité en énergie primaire, actuellement fixé à 2,58, Équilibre des Énergies rappelle que l’énergie primaire n’est pas une grandeur physique mesurable mais un indicateur statistique résultant de l’agrégation des formes d’énergie entre elles moyennant des coefficients de pondération largement arbitraires. Équilibre des Énergies estime qu’il faudra à l’avenir ne retenir comme critère que l’énergie livrée à l’utilisateur et consommée par lui, et bannir tout recours à l’énergie primaire dans la réglementation.
A titre de solution transitoire, Équilibre des Énergies avait proposé à l’administration de s’aligner sur le coefficient par défaut de 2,1 préconisé par la Commission européenne. Selon la législation communautaire, le choix d’un autre coefficient par les États doit se faire en « prenant en compte de leurs bouquets énergétiques figurant dans leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat qui doivent être notifiés à la Commission conformément au règlement (UE) 2018/1999 ». C’est donc dans une vision moyen terme qu’un coefficient autre que le 2,1 doit être justifié.
- S’agissant du contenu en CO2 du kWh électrique, les messages les plus fantaisistes circulent allant jusqu’à imputer au kWh électrique utilisé pour le chauffage, un contenu en CO2 de 500 à 600 g de CO2 alors qu’à aucun moment, au mois de janvier 2020 par exemple, les émissions n’ont excédé 76 g/kWh. Ces divergences résultent de deux erreurs profondes :
- d’une part une application abusive du principe du coût marginal dont tous les économistes savent que le résultat dépend du point de vue que l’on adopte pour le calculer ;
- d’autre part la méconnaissance de la mutualisation des productions apportée par le réseau électrique.
A titre d’exemple, on sait que la France est très généralement exportatrice d’électricité et souvent en hiver au moment où les chauffages des logements sont en activité. Les conventions utilisées jusqu’à présent postulaient que l’électricité exportée était réputée être d’origine nucléaire donc décarbonée alors que l’électricité utilisée pour le chauffage provenait de moyens de pointe utilisant des combustibles fossiles !
La seule façon correcte de raisonner est de considérer qu’à tout moment un kWh électrique produit a le même contenu quel que soit l’usage auquel il est destiné. En intégrant ce principe sur une année, avec un pas de temps aussi fin que possible, il est alors possible de définir des contenus moyens annuels en CO2 du kWh par usage et donc pour le chauffage en particulier. L’Administration a choisi de faire cette intégration par période d’un mois, ce qui est un progrès par rapport aux pratiques antérieures. Mais il sera souhaitable d’affiner ce calcul dès que les données disponibles, en réalisation comme en prévision, le permettront.
Bien entendu, les mêmes principes pourront s’appliquer à toutes les formes d’énergies y compris fossiles, dès lors qu’elles seront décarbonées et représenteront une fraction appréciable des quantités livrées.
Plus d’informations sur : https://www.equilibredesenergies.org
 La stratégie énergétique de la France ne passera finalement pas par la loi
La stratégie énergétique de la France ne passera finalement pas par la loi
 Le décret pour encadrer le développement de l'agrivoltaïsme publié au JO
Le décret pour encadrer le développement de l'agrivoltaïsme publié au JO
 Les parkings, des espaces privilégiés pour les énergies renouvelables
Les parkings, des espaces privilégiés pour les énergies renouvelables
 A l'occasion des Européennes, Les Républicains annoncent vouloir assouplir les règlementations sur le logement
A l'occasion des Européennes, Les Républicains annoncent vouloir assouplir les règlementations sur le logement
 Le ministre du logement annonce 10 mesures de simplification pour relancer la construction sans convaincre le secteur
Le ministre du logement annonce 10 mesures de simplification pour relancer la construction sans convaincre le secteur
 Un texte visant à simplifier la transformation de bureaux en logements adopté à l'Assemblée
Un texte visant à simplifier la transformation de bureaux en logements adopté à l'Assemblée
 Statut de l'élu local : le Sénat s'attaque à la crise des vocations
Statut de l'élu local : le Sénat s'attaque à la crise des vocations
 Marché de l’électricité : l’UFC-Que Choisir et la CLCV demandent au Gouvernement de revoir une copie déjà obsolète
Marché de l’électricité : l’UFC-Que Choisir et la CLCV demandent au Gouvernement de revoir une copie déjà obsolète
 L'investissement dans la pierre va-t-il dans le mur ?
L'investissement dans la pierre va-t-il dans le mur ?
 Le taux des crédits immobiliers baisse en février, pour la 1ère fois depuis 2 ans
Le taux des crédits immobiliers baisse en février, pour la 1ère fois depuis 2 ans
 Bâtiment et immobilier : un secteur en proie aux crises mais dont la transition écologique est en marche
Bâtiment et immobilier : un secteur en proie aux crises mais dont la transition écologique est en marche
 Comment évolue le pouvoir d’achat des Français dans l’immobilier neuf ?
Comment évolue le pouvoir d’achat des Français dans l’immobilier neuf ?
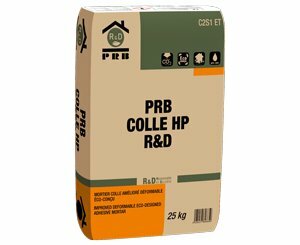 Une nouvelle colle C2S1 bas carbone entre dans la gamme « Responsable & Durable » proposée par PRB
Une nouvelle colle C2S1 bas carbone entre dans la gamme « Responsable & Durable » proposée par PRB
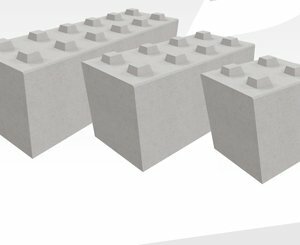 Créez, modifiez et réutilisez avec les Murs Blocs
Créez, modifiez et réutilisez avec les Murs Blocs
 Coulissant minimaliste Cero IV de Solarlux : la lumière comme protagoniste
Coulissant minimaliste Cero IV de Solarlux : la lumière comme protagoniste
 Hydro'Way, Eco'Urba, StabiWay et Baltazar... les solutions de revêtements de sols perméables de JDM Expert
Hydro'Way, Eco'Urba, StabiWay et Baltazar... les solutions de revêtements de sols perméables de JDM Expert